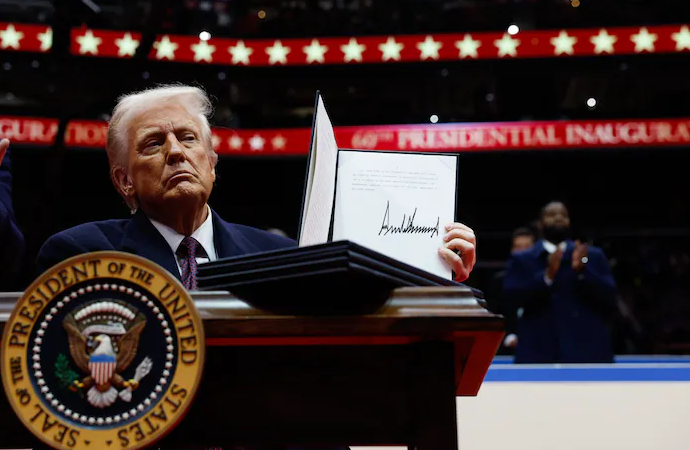En Tunisie, la fin des prénoms interdits
«Allô, bonjour, la municipalité de Bizerte? – Oui, c’est l’état civil. – Je suis à la recherche d’informations. Ma femme est enceinte. Je voulais vous demander, par rapport au prénom de mon fils, j’ai entendu dire qu’on est libres de donner le prénom qu’on veut, c’est ça? – Tu veux l’appeler comment ton fils? – Gérard. – Gérard!? Oui, apparemment, maintenant, tu peux donner le prénom que tu veux à ton enfant. – Mais comment ça “apparemment”? C’est sûr? Je n’ai pas envie de venir à la municipalité et qu’on me demande comment et pourquoi, ou d’être obligé de changer à la dernière minute. – Je sais pas, ta femme, elle est à combien de mois? – Sept. – T’as encore deux mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais pour le moment, c’est sûr, tu peux donner le prénom que tu veux.»
À l’autre bout du fil, l’officier d’état civil est catégorique: un nouveau-né peut porter un prénom non arabe. En tout cas, tant que la législation ne change pas.
Circulaire éculée
Si le père du petit Gérard, président bizertin du fan club de Depardieu, n’existe pas, cet échange a bien eu lieu à la fin du mois de juillet. Pour tester la réaction de l’administration tunisienne, quelques jours seulement après la décision du ministre des Affaires locales de libéraliser le choix des prénoms, en affranchissant les parents de toute restriction.
Bizerte n’a pas été choisi au hasard. Ces derniers mois, cette ville du nord du pays a défrayé la chronique, après que les médias tunisiens se sont fait l’écho d’une liste de prénoms mis à l’index par la mairie: Eline, Rostom, Majdouline, Yara, Ilène et autre Bayazid étaient prohibés.
Un refus systématique, assurait alors le maire de Bizerte Kamel Ben Amara, pour permettre à ses services de se conformer à la législation. Interrogé par une radio locale, il argumentait: «Avec l’émergence et la popularité des feuilletons d’autres pays, des gens ont commencé à donner des prénoms étrangers à leurs enfants. Le chef de service de l’état civil s’est retrouvé dans une position délicate, car on lui a signifié qu’il n’était pas en train de respecter la loi.»
Le maire invoque l’interdiction de donner des prénoms non arabes, prévue par une circulaire datant du 12 décembre 1965.
Le texte ne s’applique plus, désormais. Dans une lettre envoyée aux maires le 16 juillet, le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoun a justifié sa décision d’annuler cette vieille circulaire contraignante: les interdictions de prénoms représentent, écrivait-il, «une forme de restriction de liberté»; elles ne sont plus «compatibles avec le climat de liberté et de responsabilité qui règne en Tunisie aujourd’hui».
À LIRE AUSSI «En Tunisie, dans certains milieux défavorisés, c’est fréquent de boire de l’eau de Cologne»
Culture dominante
Par le passé, la circulaire fut à l’origine de conflits récurrents entre parents et administration. L’effort à fournir était considérable pour les familles qui optaient pour des prénoms peu courants, obligées de déployer des trésors d’imagination face à des officièr·es d’état civil trop tâtillons.
Au pays de Gisèle Halimi, une jeune femme, la vingtaine, porte le prénom de cette avocate figure du féminisme et de la décolonisation. Une évidence. Pas pour l’administration tunisienne. Sa sœur raconte: «Mon père a débarqué là-bas avec un dictionnaire sous le bras, comme preuve. Pour qu’ils acceptent le prénom, mes parents avaient trouvé un mot en arabe à la sonorité très proche, “jazilan”.»
Le subterfuge a fonctionné. Sa sœur s’appelle Gisèle mais, elle, porte un nom bien arabe et tunisien, Hind. Elle aurait dû s’appeler Isis, «comme la déesse». «[L’administration] est chelou, j’espère que cette annulation changera la situation. Bon, que ça facilite le truc, parce que ça restera toujours une question de mentalité.» Chez cette Isis contrariée pointe l’amertume des parents, dont le choix de prénom pour leur première fille fut imposé par l’État.«Mon père a débarqué là-bas avec un dictionnaire sous le bras, comme preuve.» Hind
Amira, de son côté, veut porter l’affaire devant la justice. Elle avait choisi Elissa et Kahena pour sa fille. Inspirés de l’histoire tunisienne, les noms font référence à deux reines, respectivement carthaginoise et berbère. L’officier d’état civil en a décidé autrement, «par pure bêtise».
«C’est mon mari qui est parti faire l’enregistrement, moi je n’aurais pas abdiqué pour si peu, témoigne-t-elle. C’était en août 2016, [l’agent en question] a rigolé en lisant les prénoms: “C’est trop de pouvoir ça, pour une seule personne”… Quand mon mari m’a raconté, je lui ai rétorqué qu’on aurait pu l’appeler Mohamed Elissa, ça serait passé» –une blague pour dénoncer l’absurdité de la situation, mais Amira prend l’affaire au sérieux.
Elle poursuit: «Je compte demander le changement très bientôt. C’était à Nabeul [petite ville située au sud de Tunis]. Je reste convaincue que si on était partis à Mutuelleville ou Carthage [deux quartiers huppés de la région de Tunis et réputés plus ouverts], cela n’aurait posé aucun problème.»
L’arbitraire est total: tout dépend de la mairie et de l’officièr·e d’état civil. De fait, il n’existe pas de «liste exhaustive des prénoms arabes et de ceux qui ne le sont pas»; «l’administration accepte ou refuse selon des critères vagues», écrit le docteur en droit public Mohamed-Amine Jelassi dans son article «Quand l’État choisit les prénoms de nos enfants».
Le texte a été publié dans l’ouvrage collectif Les Circulaires liberticides – Un droit souterrain dans un État de droit!, édité par l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI). Il dénonce «une vision restrictive qui limite le choix à l’appartenance arabo-islamique et porte atteinte à la liberté des parents de donner un prénom à leur enfant».
Dans son réquisitoire contre la circulaire du 12 décembre 1965, Mohamed-Amine Jelassi explique que les restrictions sur les prénoms sont au service d’une culture dominante et finissent par occulter la diversité de l’identité tunisienne. La minorité berbère dénonce ainsi, depuis plusieurs années, des mesures discriminatoires.
À LIRE AUSSI Un parent sur sept regrette le prénom de son enfant
Victoire amazighe
Quand les parents décident de contester, c’est le tribunal administratif qui est amené à trancher. Les associations amazighes connaissent bien la procédure.
Celles-ci ont pris leur essor après la révolution, profitant du vent de liberté qui a soudain soufflé sur la Tunisie. L’acceptation des prénoms berbères fait partie de leur combat, plus large et politique, pour la reconnaissance de leur culture et de la diversité de la société tunisienne. Plusieurs affaires sur le sujet ont fait la une, notamment en 2013 et en 2018.«En cas de recours, les parents obtiennent toujours gain de cause. Le problème, c’est d’engager ces démarches, juste après la naissance.» Mohsen Esseket, président de l’association Tamaguit pour les droits, les libertés et la culture amazighe
Revenant de manière répétée dans l’actualité, la question a enfin obtenue une réponse claire, se réjouit Mohsen Esseket, soulagé. «Lotfi Zitoun nous a épargné des années de lutte», souffle le président de l’association Tamaguit pour les droits, les libertés et la culture amazighe.
«Ça m’a beaucoup surpris, reconnaît-il. Quand j’ai vu l’info, je n’en ai pas cru mes yeux. Nous sommes très contents. Les gens se plaignaient de ça depuis longtemps. Ils veulent de plus en plus donner des noms amazighs à leurs enfants; il y a des municipalités qui acceptent, mais beaucoup refusent […]. En cas de recours, les parents obtiennent toujours gain de cause. Le problème, c’est d’engager ces démarches, juste après la naissance: c’est décourageant pour les parents.» Ce sera maintenant beaucoup plus facile, pense-t-il.
Il s’agit d’une victoire pour la culture amazighe, qui a beaucoup souffert en Tunisie des politiques de développement et d’alphabétisation de l’après-indépendance et qui tente aujourd’hui de s’extirper de plusieurs décennies de marginalisation.
Cela faisait des années que les associations réclamaient l’abandon de la circulaire de 1965, et c’est un ministre d’origine amazighe qui a satisfait leur revendication. Serait-ce un hasard ou cela permettrait-il de comprendre pourquoi un homme politique issu d’Ennahdha, parti d’inspiration islamiste, a pris cette décision?
«Il y a plusieurs courants au sein de la formation politique, et la plupart sont contre nous. Ils sont habités par l’esprit arabisant, nationaliste, affirme Mohsen Esseket. L’islam, lui, n’a pas de problème avec les différences culturelles.»
Lotfi Zitoun, depuis démis de ses fonctions de ministre des Affaires locales, acquiesce: la religion n’y est pour rien, «c’est une responsabilité qui incombe aux parents». Donner le prénom de son choix à son enfant est un droit, une liberté qu’il fallait défendre, avance Zitoun, qui préfère justifier ainsi sa démarche plutôt que de mettre en avant ses origines berbères de Matmata.
À LIRE AUSSI Fañch, le bébé breton «arme de destruction de la République»
Auto-régulation et créativité
L’ancien ministre accepte volontiers la proposition d’interview d’un journaliste étranger pour parler de cette circulaire qui lui «tient à cœur» –un texte dont il admet ne pas avoir, au début, saisi «la portée». Il a été surpris par «les nombreuses réactions» qu’il a provoquées, «très positives».
«Après la révolution, on a commencé à interdire les noms turcs, perses, pourtant très répandus. Les fonctionnaires des municipalités prenaient des libertés»: un comportement «contraire à la démocratie», qui doit garantir le respect de la vie privée, dénonce Zitoun.
Aujourd’hui, il est attaqué par les plus conservateurs (un imam extrémiste est même allé jusqu’à le traiter de mécréant) et critiqué par des membres de son parti, «des anciens rigides» qui y ont vu une atteinte à l’identité tunisienne.
Lotfi Zitoun fait confiance à la société pour s’auto-réguler; il estime qu’une «minorité» de Tunisien·nes s’écarteront des traditions. Il a donc décidé de revenir à la loi de 1957 réglementant l’état civil, qui n’interdit pas les prénoms non arabes.
«Beaucoup
[au sein d’Ennahdha]
ont soutenu l’initiative, surtout les jeunes qui ont des enfants à nommer», s’amuse l’homme politique, très satisfait de son coup d’éclat. «Je savais que la durée de vie des ministres en Tunisie est courte», continue-t-il. Il fallait donc faire vite et efficace.«Ce qu’on va peut-être observer, c’est des modes qui vont naître en bas de l’espace social.» Baptiste Coulmont, sociologue
Baptiste Coulmont, sociologue, est l’auteur de plusieurs livres sur les prénoms en France. Il partage l’avis de l’ex-ministre tunisien: «Soit il y a une auto-régulation, soit il y a 80% des gens qui continuent à faire un peu comme avant et 20% des gens qui n’ont font qu’à leur tête. Ces 20%, ce sont des personnes qui sont en Tunisie, mais dont toutes les influences sont ailleurs.»
«Il y aura du bruit comme en France, anticipe-t-il, car il y a des parents qui choisissent des prénoms totalement différents des autres prénoms.» L’intérêt pour l’État tunisien est certain, souligne le spécialiste: la mesure doit permettre de désencombrer les tribunaux de ces affaires d’état civil.
Les villes tunisiennes, connues pour leurs positions réactionnaires, appliqueront-elles la nouvelle circulaire ou continueront-elles leur travail de sape, pour tenter de décourager les parents d’appeler leur enfant comme ils l’entendent? «C’est sûr qu’il y aura toujours des difficultés», prédit Lotfi Zitoun, mais «le tribunal administratif fera appliquer la loi».
Si l’on ne peut présager de la réaction des Tunisien·nes face à cette nouvelle liberté, Baptiste Coulmont tente une hypothèse: «Ce qu’on va peut-être observer, c’est des modes qui vont naître en bas de l’espace social» et qui vont se succéder plus rapidement.
La créativité dans le choix du prénom devrait se démocratiser. Avant, avec la circulaire, «que les goûts bourgeois soient acceptés, cela ne posait pas de problème. Les personnes qui ont beaucoup de ressources peuvent toujours innover et l’officier d’état civil applique ce qu’on lui demande».
L’influence de la culture populaire et de l’étranger se ferait déjà sentir depuis plusieurs décennies en Tunisie. Les telenovelas mexicaines, très à la mode dans les années 1990, ou plus récemment les séries turques auraient laissé des traces. Avis aux Raquel et autres Aylan qui voudraient témoigner. Mais ces prénoms sont-ils vraiment portés? Il y a de quoi soupçonner une légende urbaine, un fantasme de conservateurs en plein cauchemar, car sur les réseaux sociaux, impossible d’en dénicher.