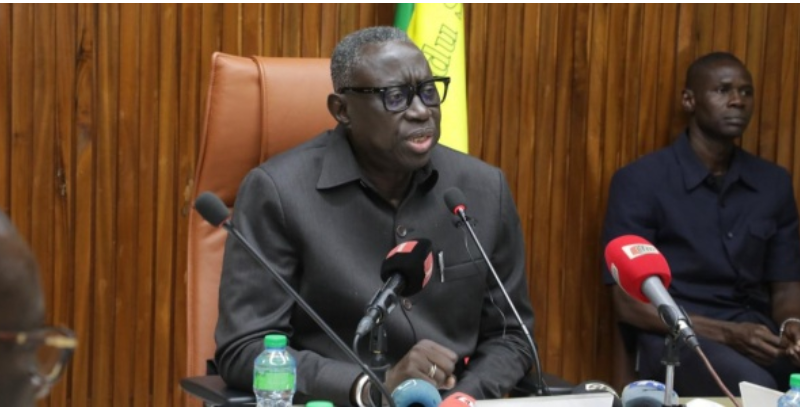La lutte anticorruption en Afrique, « arme » à double tranchant
Réclamée par les sociétés civiles et les partenaires occidentaux, cette nouvelle croisade contre les détournements est aussi devenue une subtile façon de neutraliser ses adversaires politiques.
redoutable. D’Alger à Pretoria, de Luanda à Abuja en passant par Libreville, la lutte anticorruption est de plus en plus prisée. Et les déclarations de « guerre » contre ce fléau se systématisent sur le continent africain. Pour les dirigeants, elle permet de tenter d’assainir l’économie, de séduire la communauté internationale et d’améliorer son image auprès de l’opinion publique. Forcément vertueuse, d’apparence du moins, elle a aussi l’avantage, une fois manipulée, d’être un puissant outil de neutralisation d’alliés encombrants et d’adversaires politiques.
Cette dualité peut à la fois ravir, effrayer et constituer un dilemme politico-économique. Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y est aujourd’hui confronté. La nécessaire lutte contre la grande criminalité économique reste l’une de ses « priorités ». Même si, depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, le chef de l’Etat a montré ses limites face à une série de scandales de détournements présumés de fonds publics de centaines de millions de dollars.
Risque d’instrumentalisation politique
Sa marge de manœuvre est réduite par son alliance nouée avec son prédécesseur, Joseph Kabila, considérablement enrichi, avec ses proches, durant sa présidence (2001-2019). Dans l’espoir de réduire l’influence persistante de cet ancien président, des partenaires occidentaux de la RDC – Etats-Unis en tête – incitent Félix Tshisekedi à recourir à une lutte contre la corruption plus agressive. Quitte à user à nouveau de sanctions économiques, « si nécessaires » contre « quiconque fait obstacle au changement », comme l’a récemment dit un diplomate américain.Lire aussi Félix Tshisekedi : « J’ai trop de travail et pas de temps à perdre avec des règlements de comptes »
Sur le marché de l’équipement anticorruption, le président Tshisekedi a le choix. Il a d’ailleurs sollicité le soutien de la France pour renforcer le cadre juridique et créer une agence dédiée. Sauf que son ministre de la justice, un fidèle de Kabila, préférerait importer le modèle français d’unParquet national financier dans l’espoir de l’encadrer. Pour chaque camp, au sein de ce pouvoir congolais bicéphale, l’enjeu est de pouvoir orienter cette « arme » qui, au moment idoine, servira à fragiliser l’autre. Au risque de perpétuer l’instrumentalisation de la lutte anticorruption à des fins politiques.
« La dynamique mondiale de l’intégrité »
Sous pression de leurs partenaires occidentaux qui ont, pour certains, pleinement profité de régimes corrompus et répressifs, nombre de pouvoirs africains se sont plus ou moins adaptés pour faire évoluer leurs institutions. Une manière d’éviter l’interruption de l’aide de la communauté internationale – qui fut et reste exposée aux détournements. Après le cycle de « démocratisation » des années 1990, est venu le temps de la transparence et de la « bonne gouvernance » mesurée par une série d’indicateurs faisant office de notations.Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Luanda Leaks » : la mainmise d’Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique, sur les finances de l’Angola
Au début des années 2000, agences et commissions anticorruption fleurissent, comme autant de sésame pour « s’inscrire dans la dynamique mondiale de l’intégrité », selon le politiste camerounais, Stéphane Bobé Enguéléguélé. Dans une étude pour l’Open Society, il constate que « les agences de lutte contre la corruption sont instituées en fonction d’enjeux locaux, de rapports de force politique, d’affrontements au sein des réseaux d’acteurs intéressés ».
Le président camerounais, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, démontre assez tôt sa capacité à dévoyer le concept de lutte anticorruption, à jouer de la faiblesse de ses propres institutions et de la naïveté des bailleurs de fonds pour renforcer son système autocratique. Lancée en 2006, sa grande opération anticorruption baptisée « Epervier » s’est muée en une purge politique conjuguée à une manipulation du pouvoir judiciaire par l’exécutif.
L’espoir nigérian
En même temps, de l’autre côté de la frontière, au Nigeria, géant pétrolier longtemps miné par des coups d’Etat et d’immenses détournements de fonds publics, une expérience bien plus audacieuse se déroule. L’ancien officier de police Nuhu Ribadu s’est vu confier par le président Olusegun Obasanjo la direction de la Commission sur les crimes économiques et financiers (EFCC), la principale agence anticorruption créée en 2002. Trois ans plus tard, il fait condamner son ancien chef de la police – qui fut également un soutien du chef de l’Etat – et lance une vaste enquête contre 31 des 36 gouverneurs de la fédération. Tout en traquant et rapatriant quelques-uns des milliards de dollars détournés par les régimes précédents.Lire aussi Ibrahim Mustafa Magu, le shérif anticorruption du Nigeria
Surnommé l’« Eliot Ness » africain, M. Ribadu ravive alors l’espoir d’une lutte anticorruption institutionnalisée. Il sera toutefois mis à l’écart, en 2007, par le même président Obasanjo qui, conscient de la puissance de cet instrument, va affaiblir l’EFCC en orientant les enquêtes contre son ambitieux vice-président et ses opposants. Une ingérence politique qui perdure aujourd’hui encore. Sauf que c’est Obasanjo qui la dénonce depuis qu’il a été visé par des enquêtes de l’EFCC. Celle-ci, désormais dirigée par un proche du président Muhammadu Buhari, reste une référence sur le continent malgré les critiques sur la politisation de ses investigations.
Exigence de résultats
« Si les luttes anticorruption restent encore largement instrumentalisées en Afrique, l’exigence de résultats ne vient plus seulement des instances internationales, observe un cadre d’une institution financière internationale en poste sur le continent. La société civile, et plus largement la population jeune et intransigeante, ne veut plus se faire duper ni par des responsables corrompus ni par ceux qui prétendent combattre la corruption. »
Des activistes n’hésitent plus à mobiliser et à interpeller leurs chefs d’Etat. Au Mali et à Madagascar, des magistrats déterminés et indépendants osent mener des enquêtes sur des oligarques, des caciques du crime organisé, des généraux, pour certains couverts par les présidents.Lire aussi « Luanda Leaks » : le rôle trouble des géants de l’audit
Même si le plus souvent encore, les pouvoirs en place prennent soin de garder sous leur contrôle la lutte anticorruption pour mieux profiter de sa dualité. C’est ainsi que de puissants partis-Etats issus des mouvements de libération, comme le MPLA en Angola et l’ANC en Afrique du Sud, y recourent de plus en plus ; eux qui ont longtemps géré les affaires de corruption dans le huis clos de leurs instances. Quitte à déballer publiquement les malversations de certains ex-présidents ou hauts cadres sacrifiés et ainsi tenter d’accélérer, en interne, la mue de ces partis vieillissants soucieux de préserver leur emprise politico-économique.
Cette lutte anticorruption sélective, opportune et rentable s’est banalisée et n’épargne plus les facilitateurs occidentaux (cabinets de conseil et d’audit, avocats, banques…). Cette « arme » a éprouvé, en Afrique, sa puissance de destruction sur des champs de bataille politique. Elle doit encore prouver qu’elle peut échapper aux manipulations pour contribuer à servir l’intérêt général.